![]() Par Nick Olaizola 20 août 2023
Par Nick Olaizola 20 août 2023
Vous avez été probablement exposé à une forme de drogue durant votre existence (théine, caféine, nicotine, etc.). Mais certaines drogues sont si dévastatrices que rien que d’entendre leur nom pourrait- vous faire frissonner.

Notons que ce classement est à prendre avec des pincettes, car les effets et les classifications peuvent varier en fonction de nombreux facteurs. Citons essentiellement la dose, la pureté, l’individu et la manière dont la drogue est consommée. Pour l’occasion, ce Top 10 des drogues les plus puissantes et dangereuses au monde est principalement basé sur le critère de toxicité, de dépendance et l’appréciation sociale.
Voici en tout cas une liste de certaines des drogues considérées comme parmi les plus puissantes et dangereuses au monde.
10 – Le champignon magique – Psilocybe cubensis
Bien que considérés comme moins dangereux que les autres drogues telles que les opiacés synthétiques, certains champions hallucinogènes sont particulièrement puissants en termes considérés comme puissants en termes d’effets psychédéliques. Le psilocybe cubensis, aussi connu sous le nom de « champignon magique », peut provoquer des expériences visuelles anormales, telles que des couleurs vives, des motifs géométriques et des distorsions perceptuelles.
En tant que puissant hallucinogène, il peut engendrer de l’anxiété, de la paranoïa, voire des crises de panique. Cela peut conduire à une altération du jugement et de la perception du danger, et donc à des décisions risquées.
Cette drogue est également liée à des risques psychologiques. En effet, les personnes prédisposées à des troubles mentaux tels que la schizophrénie peuvent voir leurs symptômes exacerbés par l’utilisation de champignons hallucinogènes.

9 – La drogue du zombie – Xylazine
Cette drogue a récemment été à l’origine d’images terrifiantes ayant fait le tour des médias sociaux. Les vidéos montrent des cités macabres où les gens se comportent littéralement comme des zombies sous l’effet de la substance. Une fois injectée, elle peut causer de la somnolence, un ralentissement de la respiration ou du rythme cardiaque, des lésions cutanées plus ou moins graves, etc.
La xylazine est à l’origine utilisée comme un sédatif pour animaux, dont les chevaux. Son usage a ensuite été détourné à des fins récréatives. Elle est notamment utilisée pour servir d’agent de coupe avec d’autres drogues comme le Fentanyl.
Actuellement, la xylazine est considérée comme « menace émergente » aux États-Unis. Le nombre de décès par overdose a dangereusement augmenté ces dernières années. Un reportage de Le Point a d’ailleurs relaté que cette drogue a récemment été repérée en France.
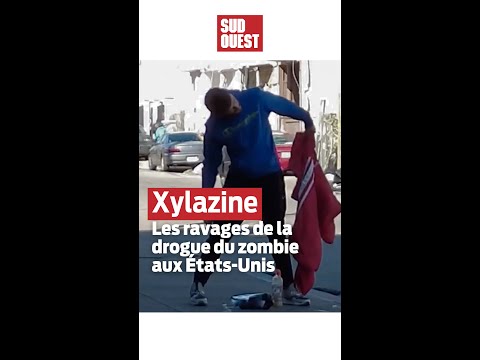
8 – L’héroïne – Acétomorphine
L’héroïne est l’une des drogues qui tuent le plus au monde par overdose. En effet, L’overdose d’héroïne constitue un risque majeur. Les doses varient en pureté, et il est difficile pour les personnes qui en consomment de connaître la concentration réelle de la drogue. Une surdose d’héroïne peut entraîner une dépression respiratoire grave, une perte de conscience et la mort.
De plus, c’est un opiacé très addictif. Elle peut provoquer une dépendance physique et mentale sévère. Outre les effets mentaux et psychologiques, les problèmes sociaux et personnels, l’héroine peut provoquer des soucis de santé graves tels que des infections, des maladies cardiaques, des problèmes pulmonaires et des lésions hépatiques. L’injection d’héroïne peut également augmenter le risque d’infections transmises par le sang, telles que le VIH et l’hépatite C.

7 – La cocaïne – Benzoylecgonine
La cocaïne est un stimulant puissant qui peut engendrer de graves problèmes cardiaques, respiratoires, mentaux et psychologiques. La dépendance s’installe rapidement. De plus, le risque d’overdose avec cet alcaloïde tropanique extrait de la feuille de coca est particulièrement élevé. La cocaïne est également associée à des dommages nasaux et des comportements à risque, des conséquences sociales et professionnelles négatives, ainsi que des implications légales.
Une étude post mortem de sang et d’urine a d’ailleurs été réalisée sur près de 2500 corps. Parmi 668 cas de mort subite, les résultats ont révélé 21 décès imputables à une addiction à la cocaïne. C’étaient tous des hommes, âgés de 27 à 42 ans. Les causes des décès étaient essentiellement cardiovasculaires (62%) et cérébrovasculaires (14%) principalement.

6 – Le crystal meth – Méthamphétamine
Stimulant hautement addictif, cette drogue synthétique est hautement dangereuse. Elle peut causer des problèmes cardiaques, dentaires, cérébraux et psychotiques. Le crystal meth est également associé à des risques d’overdose. Les conséquences négatives s’étendent aux relations, à la vie professionnelle et sociale.
La méthamphétamine crée rapidement un état d’euphorie semblable à celui procuré par la cocaïne, mais plus prolongé. Il provoque une augmentation de l’éveil et de la vigilance, une impression de grande confiance en soi, une meilleure humeur ainsi qu’une amélioration des capacités sociales. On l’appelle aussi “drogue du travail” puisque le sujet n’a plus ni appétit, ni ennui, ni sommeil.

Anecdote : Pour la petite histoire, pendant la Seconde Guerre mondiale, le régime nazi allemand a été impliqué dans la production et la distribution de méthamphétamine à des fins militaires. Les nazis ont développé une version de la méthamphétamine appelée « Pervitin » pour stimuler les troupes et les maintenir éveillées et alertes pendant de longues périodes de combats et de marches.
5 – L’ecstasy – Méthylènedioxyméthamphétamine (MDMA)
Également connue sous le nom d’ecstasy, cette puissante drogue synthétique est souvent associée aux contextes de la fête et des festivals en raison de ses effets stimulants et empathogènes. Toutefois, le MDMA peut causer des effets secondaires graves. Il s’agit notamment de problèmes cardiaques, d’une surchauffe corporelle, de dommages aux reins et de troubles mentaux.
Cette drogue représente des risques accrus de surdose. Le fait est que le contenu des comprimés peut être incertain. La variabilité des pilules sur le marché illicite ajoute à l’incertitude des effets et des risques. Elle est aussi addictive. Le taux de décès liés à cette drogue est stable. Par contre, le MDMA a été cité comme produit posant le plus de problèmes par 1300 personnes prises en charge dans les CSAPA, en 2016.

4 – Le crack
Le crack est une forme cristallisée hautement concentrée de cocaïne. C’est un stimulant extrêmement puissant et addictif. Le nom « crack » vient du bruit de craquement caractéristique que les cristaux émettent lorsqu’ils sont chauffés.
En raison de sa nature hautement concentrée et de la méthode de consommation, le crack est souvent associé à un risque élevé de dépendance rapide et à des problèmes de santé graves. Les effets secondaires négatifs peuvent inclure des problèmes cardiaques, respiratoires, neurologiques et psychologiques.
3 – La drogue crocodile ou krokodil – Désomorphine
La mort peut survenir dès la première injection de désomorphine. Dans tous les cas, la durée de vie moyenne du sujet est de deux ans après la première consommation. Cette drogue a particulièrement fait des ravages et Russie et en Sibérie. Son nom vient du fait que la peau prend l’aspect de celle du crocodile à cause de la nécrose irréversible qui s’installe à partir du point d’injection. Par la suite, des plaques apparaissent sur le corps. Elles deviennent grises puis vertes. L’amputation est souvent la meilleure option pour sauver la personne.
Il s’agit d’un dérivé de la morphine, une drogue synthétique fabriquée à partir d’ingrédients dangereux et toxiques. Accessible à bon marché, la substance provoque les mêmes effets que la morphine. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle certains l’appellent “héroïne des pauvres”. Initialement conçue comme antidouleur, cette substance n’a pas été réellement exploitée dans le milieu médical en raison de la dépendance accrue qu’elle provoque. Ainsi, elle a été abandonnée en 1981 à cause de ses effets secondaires et addictifs.
2 – Le fentanyl
Le fentanyl est un analgésique synthétique extrêmement puissant. On estime qu’il est jusqu’à 100 fois plus puissant que la morphine. Une petite quantité peut être mortelle. Les décès sont la plupart du temps liés à une dépression respiratoire, qui peut conduire à l’arrêt respiratoire.
Les effets immédiats du fentanyl sont essentiellement le soulagement de la douleur, l’euphorie et la sédation.
En raison de sa puissance, il y a un risque très élevé d’overdose. Il y a aussi le fait que le fentanyl est parfois mélangé avec d’autres drogues, comme l’héroïne ou la cocaïne… Les consommateurs peuvent alors être exposés la substance sans le savoir, ce qui augmente les risques d’overdose.

1 – Le carfentanil
Le carfentanil appartient à la même classe de médicaments que le fentanyl, mais il est encore plus puissant que ce dernier. C’est décidément la plus forte des drogues. Plus précisément, des études ont montré qu’il est 10 000 fois plus toxique que la morphine, 4 000 fois plus toxique que l’héroïne et 100 fois plus toxique que le fentanyl.

:focal(2064x1382:2074x1372)/cloudfront-eu-central-1.images.arcpublishing.com/ipmgroup/ZBLI5GQKXJFGPE4NJ33P7DWF7E.jpg)




