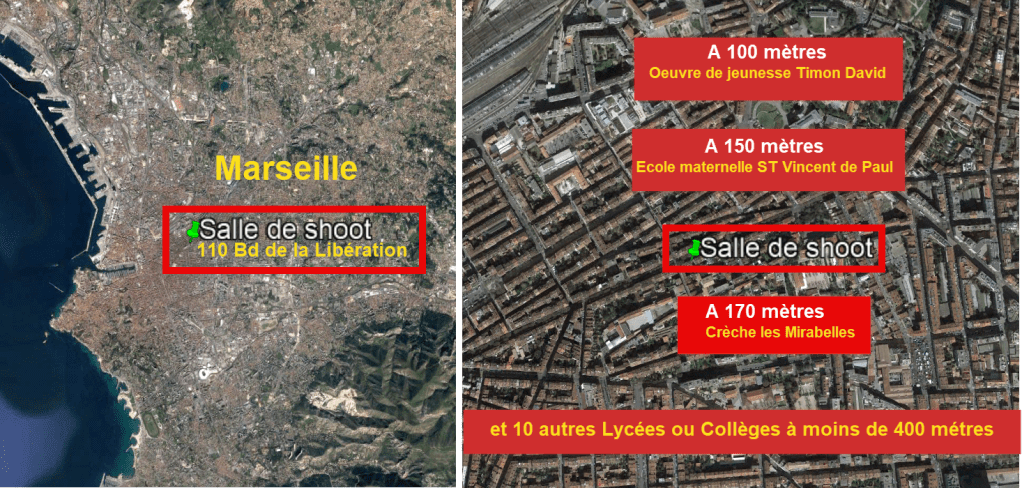Professeur Jean Costentin
dont les déclarations ne sauraient engager les institutions auxquelles il appartient ou a appartenu.
Les « salles de consommation à moindre risques » des drogues que s’injectent les toxicomanes sont expérimentées depuis 2016, à Paris et à Strasbourg. Elles arriveront au terme de cette durée d’expérimentation à la fin de cette année.
Les camps qui dès leur origine s’opposaient sur ce projet restent neuf ans après sur leurs positions. Ainsi « Médecins du Monde », l’association AIDES, l’association ASUD (Autosupport des usagers de drogues), la Fédération Addiction, plusieurs courants idéologiques situés à gauche de l’éventail politique, militent non seulement pour leur pérennisation mais aussi pour leurs multiplications.
S’y associent des addictologues qui militent de surcroît pour une légalisation de toutes les drogues. Leur attitude est surprenante, alors qu’ils sont si peu efficients pour sortir du marasme de leurs addictions les victimes de celles-ci et qu’ils n’ont rien fait et continuent de ne rien faire pour prémunir de ces drogues ceux qui en sont ou seront leurs consommateurs. Leur patientèle qui s’accroit sans cesse, les amène à requérir des dispositifs et des moyens de plus en plus importants pour leur prise en charge.
Ces « salles de shoots » s’apparentent à des soins palliatifs, à une démission devant les addictions ; attitude à l’opposé d’un combat pour guérir leurs victime. Un autre aspect de leur démission réside dans une prescription ad vitam, sans décroissance programmée des doses des opioïdes de substitution, la méthadone ou la buprénorphine à haute dose.
Beaucoup de victimes de ces addictions attendent, sans pouvoir bien l’exprimer, une prise en charge cohérente qui d’abord instaure puis ensuite consolide durablement l’abstinence ; loin d’un retour à la rue, avec accompagnement de jour dans un dispositif de réduction des risques très sommaire.
Les courants favorables aux salles de shoots disposent de forts relais médiatiques et sont épaulés par des partis politiques. Une proposition de loi visant à ouvrir des « salles de shoots », dans chaque centre d’accueil de toxicomanes (CAARUD et CSAPA) a été signée par 6 députés de la gauche parisienne, ce qui ferait 36 salles de shoots pour Paris !
Rien n’est dit du coût de cette proposition et, en particulier, aucune comparaison n’est faite avec les modèles d’accompagnement basés sur le maintien de l’abstinence avec réinsertion sociale, tel qu’il est pratiqué dans les pays anglosaxons et dans très peu de structures en France.
Alors que je présidais en 2016 le Centre national de prévention d’études et de recherches sur les toxicomanies (CNPERT), son importance relative réhaussé par la notoriété de beaucoup de ses membres, m’ont fait désigner comme le porte-parole d’un collectif formé d’une dizaine d’associations, toutes opposées à l’instauration de ces salles.
Par leurs arguments ces associations ont contribué à l’édification d’un argumentaire commun, qui pourrait avoir contribué à restreindre la prolifération de ces « salles de shoots », aux deux seules expérimentations de Paris et Strasbourg.
Selon la technique habituelle des lobbyistes / faiseurs d’opinions / influenceurs, le lexique de ces salles de shoots a été manipulé, au point d’être torturé. Il ne fallait plus dire « toxicomanes » mais « utilisateurs de substances addictives », et même plutôt de « substances » (tout court) ; ce mot substance remplaçant le mot « drogue » dès lors à bannir.
Tout comme devait être bannie l’expression trop réaliste de « salles de shoots », pour lui substituer celui de « salles de consommation à moindre de risques » ou encore, moins parlant, son acronyme SCMR ; cela, bien sûr, sans préciser ce qui serait consommé ; ne pas dire qu’il s’agit de drogues, pour ne pas heurter le contribuable, bailleur de fond de cette coûteuse entreprise.
Puis, par un tour de prestidigitation, l’appellation a été changée en « haltes de soins addictions » et plus discrètement encore « HSA ». Cela augure de leur prolifération, puisque qu’elles pourraient s’intégrer aux CAARUD / Centres d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogues (il en existe 20 en Ile-de-France, dont 9 à Paris) : et aux CSAPA (Centres de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie) au nombre de 385 ; centres financés par l’assurance maladie.
Le paysage des toxicomanies s’est profondément modifié depuis les neuf années qui nous séparent des joutes initiales
– Le narcotrafic a atteint des niveaux très inquiétants, au point de faire redouter l’instauration en France d’un Narco-État et la « mexicanisation » de notre société. En 2024 ont été dénombrés 367 assassinats et tentatives d’assassinats liés au trafic de stupéfiants, avec 150 morts.
– L’accroissement du nombre des toxicomanes. En 2017, 9,8% des adultes de 18 à 64 ans avaient consommé au moins une fois une drogue illicite autre que le cannabis, ils sont 14,6 % en 2023 , soit une hausse relative de 50 %. L’usage actuel (soit au moins un usage au cours des 12 mois écoulés) augmente de 70 % sur la même période, passant de 2,3 % à 3,9 %.
– Le nombre des héroïnomanes n’a cessé de croître. Entre 2005 et 2017, le nombre d’expérimentateurs est passé de 350.000 à 500.000, tandis que le noyau actif des consommateurs est estimé en 2023 à plusieurs dizaines de milliers de personnes ; à cela s’ajoute les consommateurs d’autres agents morphiniques codéine, tramadol, buprénorphine, méthadone. Simultanément le nombre des cocaïnomanes a explosé, affectant toutes les strates de la société, même des lycéens, avec appararition dans des soirées étudiantes dont celles de carabins.
– De nouveaux opioïdes, terriblement puissants sont apparus (fentanyloïdes, nitazènes), faisant des ravages aux USA, avec près de 100.000 décès en 2024.
– La prévention des toxicomanies reste le parent pauvre d’une Éducation nationale aux appointés-absents. Les campagnes de la MILDECA sont d’une rareté et d’une discrétion de violettes sans parfum ; semblable mutisme des addictologues, alors qu’ils sont plus bruyants et véhéments pour réclamer la légalisation de toutes les drogues.
– La dette nationale a continué de croître, atteignant des niveaux qui imposent des économies drastiques, ne pouvant épargner le secteur de la Santé. Actuellement, le coût d’une seule salle de shoot est de l’ordre de 3 millions d’€ par an…
– Un antagoniste injectable de l’héroïne (la naloxone) est désormais disponible. Il permet à quiconque de pallier, avant l’arrivée du SAMU, le risque vital d’une surdose/overdose d’héroïne, ou d’un autre morphinique puissant. Ce médicament pourrait être accessible en de nombreux lieux, au côté des défibrillateurs cardiaques.
– La contamination par le VIH, l’agent du SIDA, n’affecte plus majoritairement les toxicomanes, comme lorsqu’ils s’injectaient leurs drogue avec des seringues et des aiguilles qu’ils se prêtaient de l’un à l’autre. Une information bien diffusée, jointe à un libre accès à des seringues, souvent même gratuites, a effondré cette modalité de contamination. Il est urgent de se concentrer sur les comportements à risques qui accompagnent le « chemsex » (activité sexuelle intensifiée par diverses drogues) qui se répand et déborde les pratiques homosexuelles.
– Le SIDA, grâce aux polythérapies, n’est plus mortel. Si l’on ne sait toujours pas le guérir, on peut le prévenir chez le sujet exposé, par l’administration du Truvada®. Actuellement cette infection concerne majoritairement les homosexuels masculins.
– On avait anticipé l’opinion très défavorable des riverains de la salle de shoots qui jouxte l’hôpital Lariboisière ; ils sont nombreux aujourd’hui à estimer que leur quartier est sinistré.
Ainsi les arguments invoqués pour justifier ces salles se sont, les uns après les autres, révélés faux ou obsolètes.
Exit la prévention de la contamination par le VIH/SIDA ou par les virus des hépatites B ou C, liée au prêt de matériel d’injection entre les injecteurs.
Exit le caractère indispensable de ce dispositif pour « rattraper » les overdoses des opioïdes, par l’administration sans délai de naloxone d’un antagoniste des récepteurs opioïdes de type mu, désormais disponible en pharmacie. Pour sa large diffusion Il serait opportun qu’elle soit disponible en syrettes (seringues auto-injectables) au côté des défibrillateurs, accessibles en de nombreux lieux. Si l’héroïnomane vit péniblement un syndrome d’abstinence, à la différence de l’overdose il ne met pas en jeu son pronostic vital.
Exit l’argument jouant de l’effet d’attraction des toxicomanes vers des structures permettant leur prise en charge médicalisée » ; jouant de la stratégie des graines jetées aux moineaux pour les capturer. Pour un coût très élevé, ont été multipliées les structures permettant de rencontrer les toxicomanes : les CAARUD ; les CSAPA ; les bus méthadone ; les médecins généralistes qui peuvent leur prescrire de la buprénorphine à haut dosage (que certains revendent à de jeunes toxicophiles, pour acquérir leur héroïne avec l’argent de cette revente) ; les restaurants gratuits (type restaus du cœur) ; les maraudes avec distributions alimentaires ; les commissariats où ils sont amenés quand ils ont commis des délits ; les service d’urgence des hôpitaux où ils sont amenés par le SAMU.
Pour compléter ces dispositifs pourraient intervenir des équipes mobiles d’addictologues allant à leur rencontre, dans les lieux qu’ils fréquentent. Ce sont là autant d’alternatives à ces couteuses salles de shoots qui n’assurent même pas une permanence 24/24h, 7 jours sur 7 ….
Exitl’ argument d’une amélioration de l’ambiance de certains quartiers, et celui de ne plus voir traîner de seringues sur le sol. Le don de seringues et d’aiguilles, avec pour contrepartie l’obligation de rendre le matériel utilisé, réduit cette nuisance, qui doit tout simplement être complétée dans les quartiers fréquentés par les toxicomanes d’une attention redoublée des services de la voirie. A l’entour de ces salles se concentrent dealers et toxicomanes.
Il y a deux ans j’ai parcouru des rues proches de la salle de shoots qui jouxte l’hôpital Lariboisière. J’y ai rencontré un individu qui délirait et vociférait ; un autre qui déféquait en public ; un troisième dont le soulagement vésical s’apparentait à de l’exhibitionnisme. Un peu plus tard un couple, en partie dévêtu, semblait sur le point de s’adonner « au simulacre de la reproduction ».
La presse relate la désapprobation des riverains, certains expriment qu’ils ne se sentent pas rassurés, pour leurs enfants en particulier ; certains voudraient changer de quartier mais le prix de leurs appartements s’est beaucoup déprécié…
Des dispositions ont été prises pour déresponsabiliser les médecins qui supervisent ces salles, pour le cas où au sortir de celles-ci, des consommateurs se livreraient à des actes répréhensibles dans un état perturbé par les drogues qu’ils se sont ou qu’on leur a injectées.
Les toxicomanes, rassurés par la supervision médicale promise, seraient tentés de s’injecter de plus hautes doses de leurs drogues que celles qu’ils utilisaient auparavant ; avec pour conséquence des overdoses que, certes, l’injection de naloxone permet de sauver.
Le confort (relatif) de ces salles où s’effectue l’injection des drogues ne dissuade pas du comportement injecteur. Par un mécanisme de type Pavlovien, la drogue est associée au plaisir, l’inconfort des conditions de son administration peut rompre cette relation.
Faire profession de traiter les victimes d’addictions très délétères sans manifester fermement la volonté de les en soustraire, entretient chez le toxicomane un sentiment de désespoir ; cela revient à lui déclarer que sa maladie est irrémédiable.
Les évolutions constatées au cours de la décennie écoulée, l’invasion des addictions, l’état très inquiétant dans lequel s’est enfoncé notre Nation en matière de drogues, de toxicomanies, de narcotrafic, d’addictologie, d’endettement n’autorisent plus d’atermoiements.
Elles obligent à mettre enfin en relation les énormes moyens consacrés avec les résultats obtenus. Elles justifient, encore plus qu’autrefois, de s’opposer à la multiplication de ces « salles de consommation à moindre risques » / SCMR / «salles de shoots» / Haltes soins addictions / HSA / salles de shoots, et à la pérennisation des deux salles expérimentales.
Alors – Que faut-il faire ?
Ces dérapages incontrôlés sont la conséquence du laxisme, de la permissivité, du « jouir sans limites », de «l’interdiction d’interdire » de la féria de Mai 1968. Un certain nombre d’entre nous mesurent enfin toute les dégradations qu’ils ont occasionné.
Il est urgent de reprendre les manettes de l’addictologie, de ne plus laisser à ceux qui sont à l’origine ou ont accompagné cette décapilotade, le soin de la corriger. «On ne résout pas un problème avec les modes de pensée qui l’ont engendré» – A. Einstein ..
Il faut réintroduire dans cette gestion l’autorité qui en a été progressivement exclue. Les drogues étant illicites on dispose des moyens juridiques qui permettent de diriger temporairement le comportement de ceux qui ont abdiqué sa maitrise. L’abstinence sera pratiquée en milieu hermétique à l’entrée de toute drogue ; les pathologies somatiques et psychiatriques seront traitées.
Une attention privilégiée sera portée à une re-conformation à la vie en société, à la préparation à une activité professionnelle ; des psychothérapies de soutien, du coaching, l’aide à la découverte de centres d’intérêts sportifs, manuels ou intellectuels. Tout cela ne coûterait pas moins que des salles de shoots, mais correspondrait à une démarche authentiquement médicale, humaniste, à l’opposé d’une euthanasie lente par les drogues.
L’indispensable alliance entre le toxicomane et son médecin ne doit en aucune façon devenir une collusion pouvant s’apparenter à du deal. Il faudra préparer celui qui est emprisonné dans ses addictions à recouvrer la maitrise de son comportement, ce qui commence par l’instauration de l’abstinence. Il y a de plus en plus de « pairs aidants » et de « patients experts » formés pour intervenir dans ces nouvelles structures à instaurer ou à reproduire, qui prônent l’abstinence comme base du rétablissement. Cette abstinence est une demande très fréquente des malades dépendants qui veulent être aidés.
On s’est débarrassé trop vite du « sevrage sec », que j’ai vu fonctionner dans un centre « du Patriarche » (manoir des Creuniers à Trouville/mer). Hélas, son initiateur (L. Engelmajer) surfant sur ses succès s’est livré à des comportements répréhensibles qui ont amené à la fermeture de tous ses centres ; faisant jeter ainsi le « sevrage sec » avec les comportements répréhensible de son promoteur.
En Italie la communauté San Patrignano (Coriano, Italie), qui fonctionne depuis 1978, accueille 1300 résidents. Près de 75% d’entre eux ne replongeraient pas dans leurs addictions après avoir fréquenté cette institution pendant deux à quatre ans.
Des structures qui fonctionnent depuis 50 ans, majoritairement dans les pays anglo-saxons, s’inspirent du modèle Minnesota ; elles ont prouvé que leur efficacité était durable. Elles ont établi une très utile continuité au sein de la plus grande fraternité internationale de soutien entre malades dépendants abstinents (Alcooliques Anonymes, Narcotiques Anonymes,…), ces associations gratuites, anonymes, sont ouvertes à tous demandeurs d’aide, en présentiel ou en visioconférence, pour fuir « l’esclavage » des addictions en tous genres.
En France, dans l’esprit de cette démarche visant l’abstinence, disposant hélas de très peu de moyens alors qu’elles ont pourtant une efficacité certaine, deux centres me sont connus :
L’un, d’inspiration religieuse, l’Association Saint Jean Espérance, avec un centre d’accueil à Pellevoisin dans l’Indre (36) et une maison à Mauges sur Loire dans le Maine et Loire (49);
L’autre, laïque, EDVO (Espoir Du Val d’Oise, ou Écouter… Développer … Vivre libre … Orienter…), à Montmagny (95), animé depuis plus de trente an, avec talent, détermination, abnégation par J.-P. Bruneau et son équipe. Leurs objectifs, leurs résultats et leurs coûts sont sans commune mesure avec le fonctionnement très dispendieux d’une salle de shoots.
Leur méthode d’accompagnement des usagers, publiée sur leurs sites internet reste dans l’ombre des médias, malgré quelques reportages chaque année. Pourtant son modèle est rapidement duplicable, à bien moindre coût que les « salles de shoots », si le nouveau plan interministériel cesse de donner la priorité à la seule réduction des risques, telle qu’elle est pratiquée depuis plus de 20 ans !
Les arguments avancés par ceux qui défendaient les successivement dénommées : « salles de shoots » / « salles de consommations à moindre risques »/SCMR ; « haltes soins addictions » /HSA, se sont révélés faux ou sont devenus obsolètes. Ces salles ne sauraient donc être pérennisées et moins encore multipliées.
Les arguments que nous leur opposions ont été vérifiés. Mais plus encore la situation des toxicomanies n’a fait qu’empirer. Elle appelle une révolution dans la politique qui régit les drogues. Elle commande de bruler ce que certains ont fait ou laissé faire ; de repenser en dehors de toute idéologie, sur des bases rigoureusement sanitaires, sociales, sociétales, cette politique.
Il faudra donner toute sa place à l’éducation, à la prévention, à la prohibition ; revisiter le cahier des charges des addictologues et des structures qui ont proliféré, en portant une attention minutieuse à leurs coûts qui devront être mis en relation avec leurs résultats. Il faudra promouvoir le développement de centres tels celui de Saint Jean Espérance et celui d’EDVO.
Professeur Jean Costentin